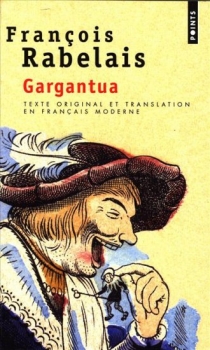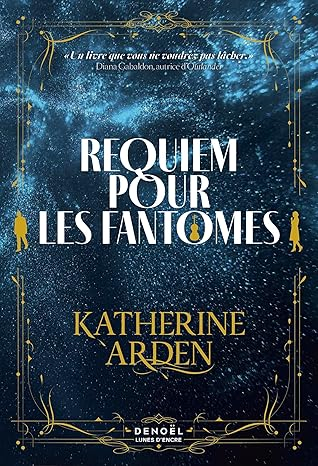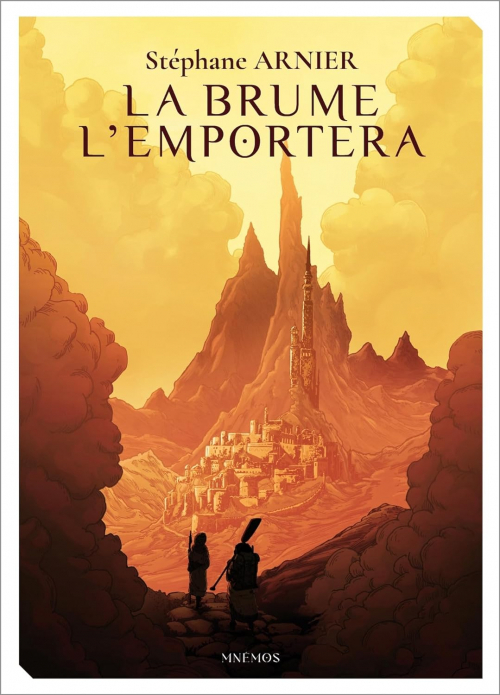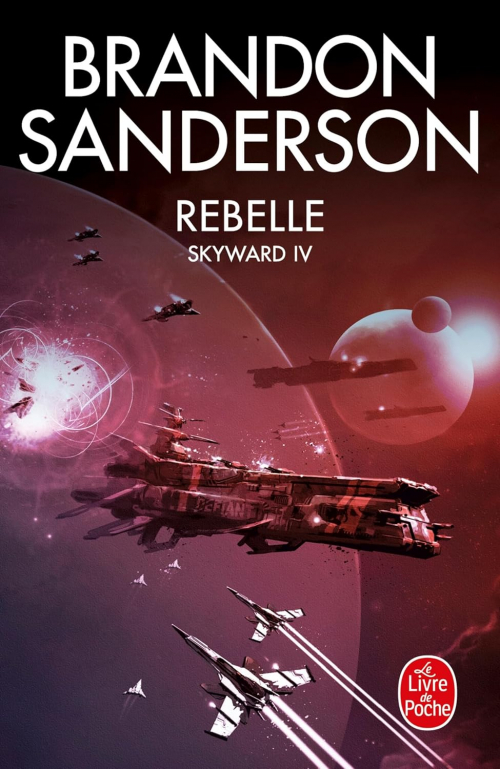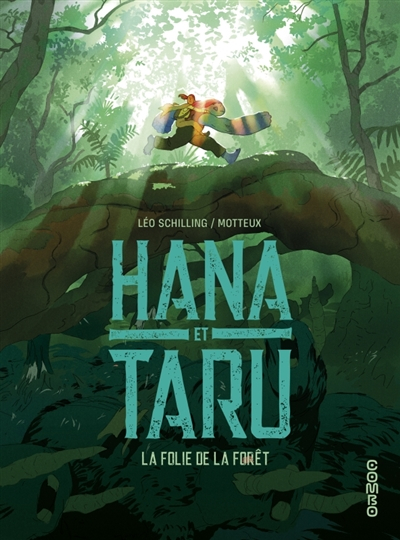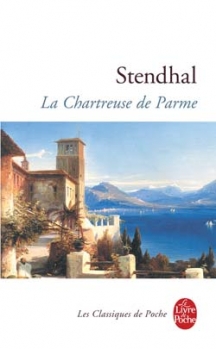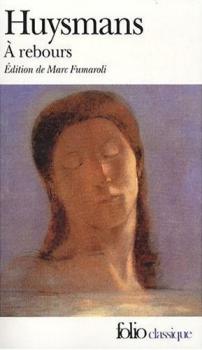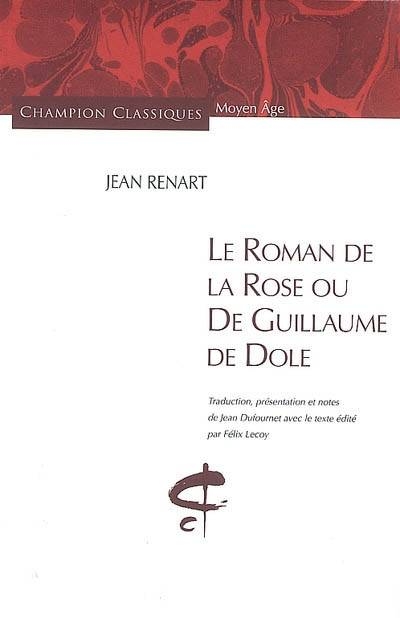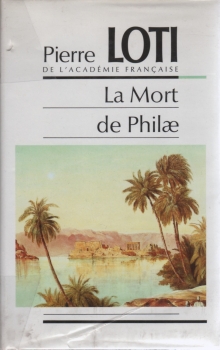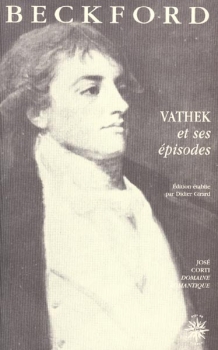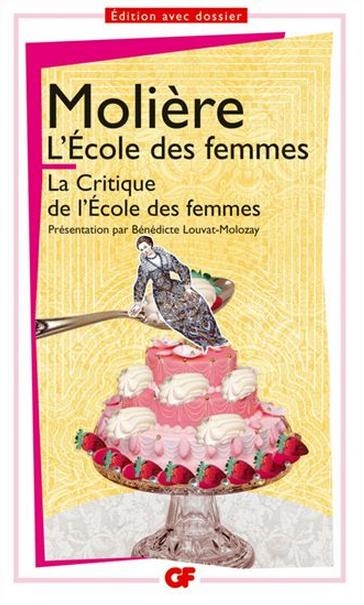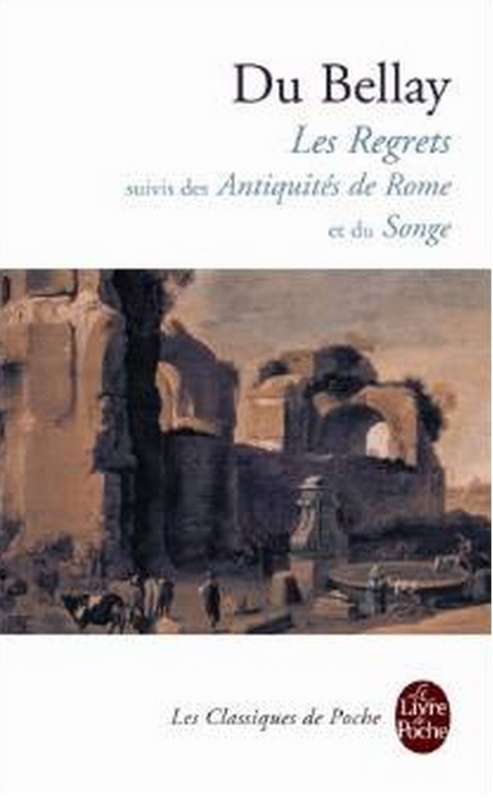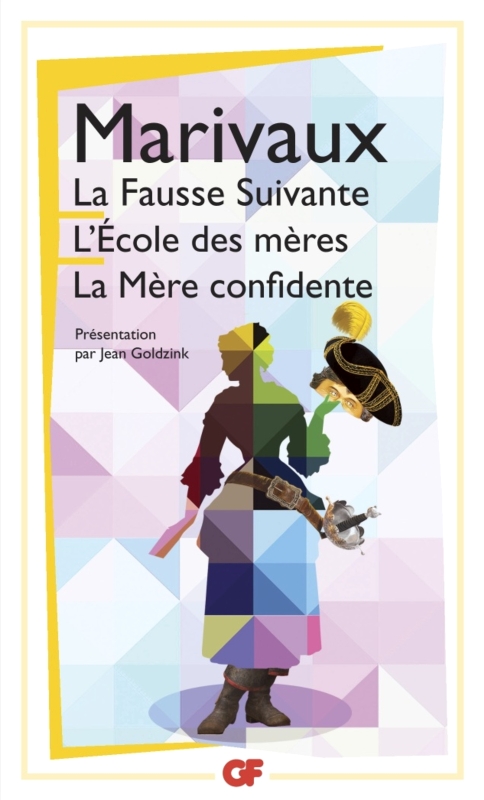Synopsis :
L’ouvrage nous entraîne dans le
monde de l’art et des artistes, à travers le portrait d’un peintre maudit,
Claude Lantier, dont le personnage évoque celui de Paul Cézanne, grand ami de
Zola, qui se brouillera avec l’écrivain après la publication du roman.
Claude Lantier est le fils de Gervaise Macquart et
d’Auguste Lantier (voir l'Assommoir, roman où l’on apprend qu’il a été amené à
l’âge de huit ans à Plassans par un vieux monsieur séduit par la qualité de ses
dessins). Il apparaît aussi dans Le Ventre de Paris. Il est ici l’ami d’enfance
du romancier Sandoz, personnage dans lequel Zola a mis beaucoup de lui-même.
Avec Sandoz et d’autres peintres ou sculpteurs, Claude combat pour imposer une
nouvelle forme de peinture, bien éloignée des canons néo-classiques qui ont la
faveur des expositions officielles. Si certains d’entre eux réussissent
finalement à s’imposer, Lantier va pour sa part d’échec en échec, demeurant
incompris du public et souvent de ses propres amis.
Mon
avis :
Une fois de plus lu dans le cadre de
mes cours, je connaissais la plume de Zola pour avoir découvert Nana en Seconde. Je savais déjà que le
style ne me dérangeait pas plus que cela, malgré quelques difficultés à
m’immiscer dans le récit.
Ce fut également le cas pour L’Oeuvre. Nous tombons sur le champ dans
l’univers de l’art au travers de Claude Lantier, fils de la célèbre Gervaise et
peintre raté. Dés le début nous percevons ses difficultés à peindre, ne
trouvant pas de sujet ou de modèle approprié à l’esprit nouveau qu’il souhaite
créer. En effet, Claude Lantier fait parti de ces artistes qui fuient le
romantisme et autres mouvements bien ancrés dans l’art ; il est à la
recherche de quelque chose de neuf, de plus distingué, qui révolutionnera le
domaine.
Tout est vu et observé selon Claude
et Christine, deux jeunes gens rencontrés dés les premières pages et qui ne
pourront plus se lâcher par la suite. Le lecteur devine aisément comment leur
histoire va évoluer, mais l’émotion n’en est pas moins prenante au détour des
pages et de leurs péripéties. En effet au travers ce couple, c’est toute la
misère conjugale que va s’amuser à décrire Zola, avec des termes forts ne
pouvant que susciter pitié et compassion chez le lecteur.
La fin représente la décadence même
de la vie. Claude devenu obsédé perdra toute notion de réalité pour se cloîtrer
dans sa volonté de conquérir ce qu’il considère comme sa plus belle toile, sans
s’apercevoir en parallèle toute la souffrance que cela procure à ses proches.
Là encore, l’émotion est forte, poignante, décuplée jusqu’à la dernière page
par l’horreur du vide à l’ultime événement du récit. Pitié, effroi, souffrance,
compassion, oui, ce livre ne peut pas laisser indifférent le lecteur,
complètement subjugué par une œuvre si bien menée.
A ma grande surprise, Emile Zola n’est
pas avare en dialogue, je n’avais pas souvenir de cela dans Nana. Or ici, chaque dialogue détient
son importance et sa richesse, que ce soit par son contenu fort et sérieux ou
par l’objectif recherché, faire naître l’émotion ou la réflexion.
Les personnages ne font pas foule dans
ce roman, confortant un esprit intime entre chacun d’eux.
Claude incarne la figure libre du
peintre consacré à son œuvre. Cette quête permet également de tenir l’argent
loin de l’œuvre, ce qui est assez original à cette époque, du moins si on
compare avec les romans de Balzac et sa Comédie
humaine. Si ce protagoniste abonde dans l’esprit expérimental des
naturalistes, il met également en avant le doute et l’amertume que peuvent
ressentir les artistes lorsqu’ils doivent faire face à l’avis du public ou aux
échecs répétés. C’est dans ces épreuves qu’entre la conviction, une notion
importante lorsque l’on se destine à un métier du domaine artistique.
A ses côtés vit Christine, jeune femme simple et sans
éducation, éperdument amoureuse de son peintre. Si le début la présente comme
une jeune femme mijaurée et agaçante, elle évoluera au même titre que son
compagnon pour devenir une femme dévouée à la cause de son mari, elle si
récalcitrante à ses peintures dans les premières pages. Pourtant l’état dans
lequel elle finira à la toute fin du récit dégagera une forte émotion qui ne
peut pas laisser le lecteur indifférent face à une situation si cruelle et
sombre.
D’autres personnages gravitent
naturellement autour de ce couple principal : Sandoz le fidèle ami
d’enfance, fidèle jusqu’à la toute fin ; Dubuche l’architecte autant raté
que Claude ; et d’autres artistes qui ne perceront pas non plus hormis un
seul, grâce à l’appui d’un riche intervenant. Toute cette diversité des
artistes confortent l’idée que l’art est un domaine fermé où se faire un nom
est une chose difficile, presque irréalisable.
Je ne suis pas assez cultivée sur les œuvres publiées
à cette époque, mais le style d’écriture me paraît assez semblable aux plumes
des autres contemporains de Zola. Même si cela est moins percutant et
dérangeant que dans les romans de José-Karl Huysmans, le style de Zola est
assez lourd, notamment par l’abondance de propositions insérées par les
virgules, amenant une abondance des détails, que ce soit dans la narration ou
les dialogues.
Pourtant une sensible légèreté se
dégage également de ses phrases, une légèreté que je serai bien en peine d’expliquer.
Emile Zola écrit sur des sujets d’importance, mais de manière à ce que nous
ayons envie de le suivre jusque dans ses bouts pour découvrir le fin mot de ses
propos.
Personnellement, je m’attendais à
quelque chose de dur à lire, car le style de notre français a fortement évolué depuis
le XIXe siècle. Or, j’ai grandement apprécié, j’ai même été emporté
par ce style si différent, si bien que je trouve que cela en fait une force
dans ce récit. Après, tout le monde ne partage pas le même avis sur la
question, il vaut mieux savoir dans quoi on se lance avant de découvrir par
soi-même !
Il n’est pas difficile de se rendre
compte que ce roman cherche à mettre en avant les vertus du naturalisme,
mouvement créé par Emile Zola lui-même. Au travers d’un Claude Lantier fuyant
le romantisme, nous retrouvons l’auteur et son envie d’un mouvement nouveau,
avec plus d’observations et d’expériences.
De plus, si les observations portent
sur la quête d’une révolution ratée dans l’art, Zola décrit également les
conditions des femmes souvent ravalées au rang d’objets dans un ménage où
l’homme est bien supérieur.
Et comme toujours, Emile Zola s’engage
dans la cause prolétaire pour dénoncer la misère de leurs conditions de vie. Ce
thème reste pourtant dans le flou ici, à tout le moins plus en retrait que d’autres,
donc je ne m’attarderai pas trop là-dessus dans cet avis.
En
conclusion, je redoutais cette plongée dans une œuvre d’Emile Zola, j’en
ressors finalement agréablement surprise. Que ce soit au travers des
personnages ou de l’enchaînement des péripéties, cette quête du renouveau dans
l’art, si on oublie la comparaison avec l’émergence du naturalisme, permet d’observer
et de décrire un monde miséreux où le talent est parfois injustement laissé
dans l’ombre par les pairs. L’émotion en ressort plus poignante, entre pitié,
compassion et souffrance partagée, accentuée par une fin bien loin de nos « happy
end » actuels. Zola fait parti des auteurs classiques à lire une fois dans sa vie.
Les autres titres de la saga :
1. La Fortune des Rougon
2. La Curée
3. le Ventre de Paris
4. La Conquête de Plassans
5. La Faute de l'Abbé Mouret
6. Son Excellence Eugène Rougon
7. L'Assommoir
8. Une page d'amour
9. Nana
10. Pot-Bouille
11. Au bonheur des dames
12. La Joie de vivre
13. Germinal
14. L'Oeuvre
15. La Terre
16. Le Rêve
17. La Bête humaine
18. L'Argent
19. La Débâcle
20. Le Docteur Pascal
- saga terminée -